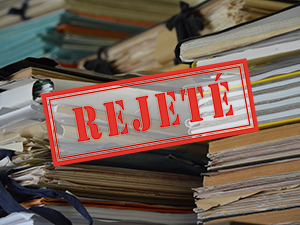De quoi les produits stimulants à inhaler sont-ils le signe ?
Un commerçant habile lance sur le marché une poudre blanche qui a les mêmes ingrédients et les mêmes effets que les boissons stimulantes. Le succès est au rendez-vous car ce produit bénéficie d’une campagne promotionnelle…



![[Dans la presse] Un vaccin pour arrêter la cocaïne, c’est possible ? (Bel RTL)](https://infordrogues.be/wp-content/uploads/vaccin-cocaine-pt.png)
![[Dans la presse] Dossier festivals : Un été de décibels (Moustique)](https://infordrogues.be/wp-content/uploads/festivals.png)
![[Dans la presse] « La consommation n’est pas le problème […] » (Le Vif)](https://infordrogues.be/wp-content/uploads/accompagnement.png)